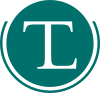Suite aux grèves que connaît notre pays, se répand progressivement au sein de l’hémicycle parlementaire l’idée d’une reconnaissance du « droit au travail ».
Le droit belge ne contient aucune disposition reconnaissant le droit de grève en tant que tel. Ce droit est consacré par de nombreux textes internationaux ratifiés par la Belgique, tels que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et surtout la Charte sociale européenne. Cette dernière énonce (art. 6.4 de la Charte) et délimite (art. 31 de la Charte) le droit de grève en précisant que ce droit ne peut subir d’autres restrictions que celles prescrites par la loi ou nécessaires pour la protection de l’ordre public et les droits et libertés d’autrui.
En Belgique, dans un temps ancien mais pas si éloigné, le gréviste était considéré comme un « hors-la-loi » coupable de commettre un délit de coalition ouvrière (article 415 du Code pénal de 1810) et d’atteinte à la liberté de travail (article 416 du Code pénal de 1810). L’abrogation de ces dispositions en 1866 et le vote en 1921 de la loi sur la liberté d’association ont été les premiers pas vers la reconnaissance du « droit de grève ». Deux événements marquent la reconnaissance définitive d’un droit fondamental démocratique dont doivent disposer les travailleurs : le premier un arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 1981, le second la loi du 11 juillet 1990 portant approbation de la Charte Sociale européenne.
Ce droit n’est toutefois pas absolu et ne permet pas toutes les dérives. Il doit permettre aux travailleurs, dans le cadre d’un rapport de force, de cesser le travail afin d’exercer une pression. La pression exercée par l’arrêt du travail n’est, aux yeux des grévistes, pas toujours suffisante d’où la mise en place de piquets de grève. Qu’est ce qu’un piquet de grève ?
L’organisation d’un piquet de grève se différencie de la grève au sens strict et consiste à monter la garde pour dissuader, empêcher les non-grévistes de travailler et bloquer l’accès aux installations. Ce sont ces piquets et les débordements qui parfois les accompagnent qui sont le fond du problème. Dans le cadre des recours « anti-piquet », les cours et tribunaux ont été amenés à de nombreuses reprises à se prononcer sur ce type de méthode. La jurisprudence autorise les piquets en considérant que les piquets ne sont qu’une « modalité » de la grève mais à la stricte condition que les participants ne se rendent pas coupables de voies de fait portant préjudice aux droits civils des employeurs et/ou des travailleurs non-grévistes. En effet, en ce qui concerne les droits des travailleurs non-grévistes, nous rappellerons le Décret d’Allarde de 1791, qui est l’un des fondements de notre loi du 03 juillet 1978 sur le contrat de travail, instaurant le principe de la liberté du travail et selon lequel il est libre à toute personne de faire tout négoce, d’exercer toute profession, art ou métier qu’elle trouvera bons.
Dans le cadre d’un référé « anti-piquet », le tribunal de première instance de Charleroi saisi en référé (Civ. Charleroi, réf., 11.12.2001, J.T.T., 2002, p. 68) a utilement rappelé les principes qui doivent commander à toute action de grève :
« (…) la participation à une grève ne constitue pas un acte illicite. Attendu que la participation à des piquets (…) ne parait pas non plus en soi illicite, dès lors que la présence de ces piquets est un appel à la solidarité des travailleurs susceptible de peser sur la conscience des non-grévistes. Que cependant les membres de ces piquets de grève ne peuvent commettre des voies de fait en portant atteinte aux droits civils de l’employeur (…) ou en empêchant le personnel non gréviste de travailler. Le droit de propriété et la liberté d’entreprise ne sont pas suspendus en cas de conflit collectif durant lequel l’employeur a le droit de se livrer à ses activités et poursuivre normalement celles-ci. Il peut donc exiger que son personnel non gréviste puisse accéder à ses installations. Le respect de ces droits civils s’impose à tous. »
Cette décision n’est pas surprenante, elle n’est que la stricte application des dispositions de la Charte sociale européenne autorisant le droit de grève et les mesures qui peuvent l’accompagner sous réserve du respect des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public.
Compte tenu de ce qui précède, l’état actuel de notre arsenal juridique nécessite-t-il de légiférer en la matière ? A ce jour aucune proposition de la loi n’a été déposée au Parlement, ce texte serait en préparation.
Affaire à suivre…