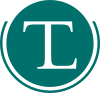La situation se rencontre fréquemment : l’employeur met à disposition de son travailleur un véhicule de société, le contrat de travail prend fin, le travailleur rend le véhicule et l’employeur considère qu’il est endommagé… Il retient le montant correspondant aux dommages sur la rémunération « de sortie » du travailleur ; souvent sur les pécules de vacances, rémunération ne faisant pas l’objet d’une protection particulière par la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération des travailleurs.
Mais est-ce légal ? La question peut être analysée sous deux angles :
- La compensation
Si l’employeur « retient » le montant du dommage sur la rémunération, il effectue une compensation. En d’autres termes, il éteint tout ou partie d’une dette grâce à une créance qu’il estime posséder sur le travailleur.
Ce type de compensation n’est permis qu’à la condition que les dettes réciproques soient liquides et exigibles. Pour être liquide, la dette doit être certaine, c’est-à-dire non sérieusement contestée. Or bien souvent, le travailleur conteste la présence de dommages au véhicule ou même l’évaluation du prétendu dommage. Dans ce cas, la compensation ne pourrait avoir lieu.
Rappelons aussi que la compensation ne pourrait opérer que pour la partie des revenus qui excèdent les seuils des quotités incessibles et insaisissables fixés par l’article 1409 du Code judiciaire. A titre d’exemple, jusqu’à 1.069,00 €, rien n’est saisissable, donc pas de compensation. Au dessus de 1.386,00 €, les saisies et donc les compensations sont illimitées.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’en ce qui concerne une grande partie de la rémunération (salaires, primes, indemnité de rupture, etc), l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 permet des retenues sans que ces retenues puissent dépasser le cinquième de la rémunération en espèce due à chaque paie.
- La responsabilité du travailleur
L’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relatives aux contrats de travail dispose que « En cas de dommages causés par le travailleur à l’employeur ou à des tiers dans l’exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu’accidentel ».
L’article 19 de la même loi complète « Le travailleur n’est tenu ni des détériorations ou de l’usure dus à l’usage normal de la chose ».
L’employeur qui souhaite engager la responsabilité de son travailleur en raison d’une absence de restitution en bon état du véhicule de société devra prouver que ce dernier a commis une faute intentionnelle, une faute lourde ou des fautes légères habituelles.
Il devra également démontrer un dommage certain et un lien causal entre la faute visée ci-dessus et le dommage. Cela revient à dire que l’employeur doit être en mesure de démontrer que le dommage constaté a été causé durant l’utilisation privée du véhicule ou que la détérioration ou/et l’usure sont dus à un usage professionnel anormal du véhicule.
On l’aura compris, si le travailleur dispose d’outils légaux pour contester la retenue sur rémunération et sa responsabilité, il appartient à l’employeur de prévoir un document contractuel (ou un chapitre dans le règlement de travail) qui détermine les bonnes pratiques d’usage du véhicule de société, notamment le fait de déclarer immédiatement toute détérioration anormale du bien et de se ménager la preuve de cette dernière.
A bon entendeur…