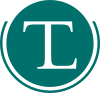Par son arrêt du 14 mai 2019 (C-55/18), la CJUE avait dit pour droit que chaque Etat membre devait imposer légalement aux employeurs de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant d’enregistrer le temps de travail journalier de chaque travailleur.
La Belgique n’a pas adapté sa législation depuis cet arrêt, contrairement à d’autres Etats (l’Espagne, par exemple).
Le Ministre Peeters avait à l’époque botté en touche et le Ministre Dermagne a ensuite renvoyé la balle aux partenaires sociaux qui n’ont toujours pas trouvé d’accord.
Un nouvel arrêt de la CJUE, dit « Loredas » du 19 décembre 2024 (C-531/23) pourrait bien inciter une potentielle future coalition Arizona à se pencher davantage sur la question.
En effet, la Cour réitère très clairement sa jurisprudence en arrêtant que le droit européen « s’oppose à une réglementation nationale, (…), et à l’interprétation de celle-ci par les juridictions nationales, selon laquelle les employeurs ne sont pas tenus d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ».
Dans ce nouvel arrêt « Loredas », la Cour va même plus loin en décidant que le droit européen s’oppose aussi à « une réglementation nationale ainsi qu’à son interprétation par les juridictions nationales ou à une pratique administrative qui se fonde sur une telle réglementation, en vertu desquelles les employeurs domestiques sont exonérés de l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail effectué par les employés de maison, privant dès lors ces derniers de la possibilité de déterminer de façon objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées et leur répartition dans le temps ».
La Cour promeut donc une application générale d’enregistrement de travail à toutes les catégories de travailleurs (moyennant certaines particularités le cas échéant, mais sans « pouvoir vider de sa substance la réglementation en cause »).
La Cour confirme à nouveau que « le fait de permettre au travailleur de recourir à d’autres moyens de preuve afin de fournir des indices d’une violation de ses droits et de renverser la charge de la preuve n’est pas en mesure de suppléer un tel système établissant de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire effectuées par le travailleur, dès lors que ce dernier est susceptible de se montrer réticent à témoigner contre son employeur en raison de la crainte de mesures prises par ce dernier de nature à affecter la relation de travail à son détriment ».
Ce dernier paragraphe critique donc directement les législations nationales (comme en Belgique) qui charge le travailleur de démontrer, certes par toute voie de droit, la prestation de ses heures supplémentaires, en l’absence d’un système objectif, fiable et accessible permettant d’enregistrer ses temps de travail.
En effet, selon la Cour, en l’absence d’un tel système : « il apparaît excessivement difficile, sinon impossible en pratique, pour les travailleurs de faire respecter les droits qui leur sont conférés par l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et par la directive 2003/88, en vue de jouir effectivement de la limitation de la durée hebdomadaire de travail ainsi que des périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire prévues par cette directive ».
A ce propos, il nous semble intéressant de constater que la Cour insiste davantage sur le fait que cette protection des travailleurs est également consacrée par « l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, à laquelle l’article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la même valeur juridique que les traités ».
Cette disposition est directement applicable dans l’ordre juridique national belge, contrairement, en principe, à une directive.
Théoriquement, un travailleur pourrait dès lors prendre moyen de cette disposition pour débattre individuellement de l’obligation de son employeur à enregistrer de manière objective, fiable et accessible ses temps de travail.
Du côté patronal, on se défend en faisant valoir qu’il appartient d’abord au législateur belge de légiférer précisément sur la question car en l’absence d’une telle réglementation nationale, ils ne peuvent être tenus d’une obligation générale découlant d’une directive européenne dans leurs rapports horizontaux avec leurs travailleurs.
Il nous semble que la jurisprudence actuelle belge met en avant un certain « juste milieu » en allégeant, d’une part, selon les circonstances, la charge de la preuve du travailleur mais en refusant, d’autre part, une application directe d’une obligation générale pour l’employeur d’enregistrer les temps de travail de tous ses travailleurs.
Les tribunaux doivent conjuguer cette jurisprudence avec le nouveau droit de la preuve, notamment pour ce qui concerne la preuve par vraisemblance ou l’inversion de la charge de la preuve. Les décisions actuelles ne dégagent pas encore de ligne cohérente. La plus grande prudence nous semble de mise.
Ce nouvel arrêt « Loredas » alimente encore les débats.
Plus que jamais, une intervention législative semble la bienvenue.